Le site de généalogie de Catherine et Michel Meste |
Mes ancêtres dans la
cathédrale Notre-Dame de Lescar
Michel
Meste (Sosa 1)
Plusieurs princes du Béarn et rois et
reines de Navarre ont été inhumés dans la cathédrale Notre-Dame de
Lescar : François Phoebus (roi de Navarre), Marguerite d’Angoulême
(sœur
de François
Ier et grand-mère de Henri IV) et d’autres, comme l’indique la
plaque de bronze ci-dessous, marquant dans l'abside l'emplacement de la crypte funéraire où ils ont été ensevelis.
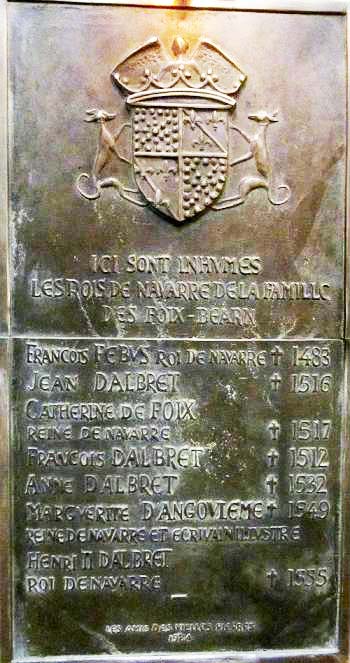
Malheureusement, leurs tombes ont été
détruites avant le début du XVIIème siècle, en particulier à la
suite des
guerres de religion.
Plusieurs
notables lescariens (plus ou moins illustres…) ont
eu par la suite le privilège d’avoir une sépulture dans la cathédrale
Notre-Dame ou dans l’église
Saint-Julien, comme en attestent leurs dalles funéraires. Cela a
été en
particulier le cas de quelques-uns de mes ancêtres (ou de leurs très
proches),
comme nous allons le voir plus loin.
Pour
ceux qui s’intéressent à l’histoire de ces deux édifices,
on pourra trouver des informations intéressantes dans les sources
suivantes :
a)
Les ouvrages de Denis
Labau : Les évêques de la Cathédrale de Lescar et
Lescar, Histoire d’une cité épiscopale du
Béarn [Marrimpouey, Pau]
b)
L’article de Wikipedia
consacré à
Notre-Dame : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame-de-l%27Assomption_de_Lescar
c)
Un article du début du
XXème sur
l’histoire de Notre-Dame de Lescar, de M. Lanore : https://www.persee.fr/doc/bulmo_0007-473x_1904_num_68_1_12548
d)
La publication de Magali
Pomente : Lescar au Moyen Âge :
organisation urbaine d’une cité épiscopale, accessible sur internet
à
l’adresse https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01094155v1/file/M1CS%20PomenteM.pdf
e)
L’article dans
Persee : https://www.persee.fr/doc/rhef_0300-9505_1931_num_17_77_2593
... Et pour ceux qui ne
peuvent pas aller à Lescar, une visite
virtuelle de Notre-Dame : https://my.matterport.com/show/?m=2dKciQjnXcN.
Les sépultures de mes
ancêtres
Les dalles funéraires dont il va être
question ici
sont mentionnées dans l’ouvrage de Hilarion Barthety (1842-1913,
historien et
archéologue du Béarn) : Les pierres
tombales de la cathédrale Notre-Dame et de l’église Saint-Julien de
Lescar [Pau
1909] , et reprises dans Gallica à l’adresse : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10560312b.r=%22les%20sepultures%20de%20Notre%20Dame%20et%20de%20saint%20julien%22?rk=21459;2
Mes ancêtres concernés par
ces sépultures sont listés
ci-dessous, et mentionnés avec leur n° Sosa (de cujus : Michel
Meste).
1.
Jean LABADOT et Anne
MINVIELLE
|
|
|
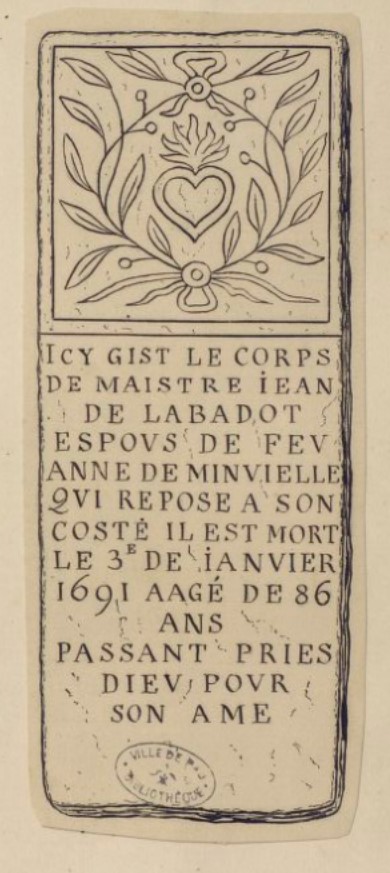 |
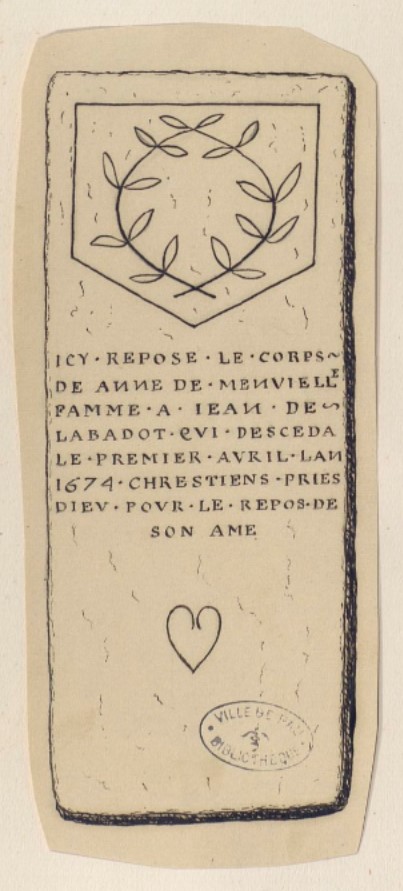 |
Il est très possible que
Jean Labadot ait été jurat de
Lescar (voir fin de texte), mais nous n’avons trouvé aucun élément probant pour le
confirmer.
De nombreux Labadot ou
Minvielle étaient présents à Lescar
depuis le début du XVIIème siècle (et certainement avant). Dans le terrier de
Lescar de 1643, on mentionne la présence de :
·
Claude Labadot dit le Boupat (au
Vialer). Précisons
que l’on trouve à Lescar un Arnaud Labadot (d’Artix, comme précisé à la
naissance de sa fille Elisabeth le 18.5.1621 à Notre-Dame) marié à une
Marie
Boupat dite Ladebat, qui ont eu deux filles en 1615 et 1621.
·
Jean Pierre de Labadot à Baroou-Dessus (à La
Hourquie)
·
Jean de Labadot, demi-frère du précédant
à
Baroou-Debat
·
…
et un nombre non négligeable de Mimbielle
(hommes ou femmes, y compris dans le vic de la Cité)
Il semble très peu
probable que notre Jean Labadot soit le
fils de Claude, étant donnée l’absence de Claude et Marie dans les
parrains/marraines de ses enfants.
2.
Henri MEILHON (de Meilhon)
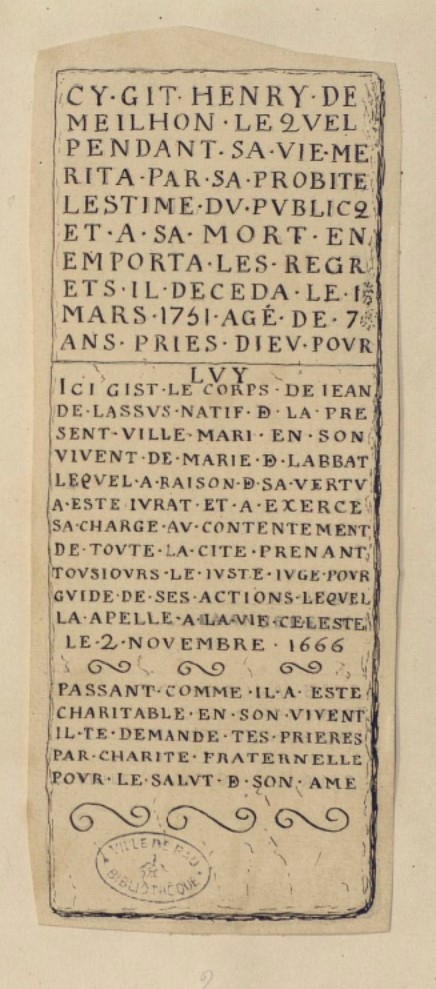 Henri
Meilhon (Sosa 298), né le 11
mars 1676 à Saint-Julien, était laboureur et a exercé la charge de jurat à Lescar. Sa tombe est elle-aussi
dans la cathédrale (voir ci-contre à droite). Il a été marié à Marie
Bourdiu dite Malecourrède. Il est décédé le 10 mars
1751 (St Julien). Il a été dit « Laprima » car sa mère
s’appelait
Domengine Lassus dite Laprima, et « Malecourrède » étant
donné le nom
de son épouse (cette dernière étant la petite-fille de Jean Bourdiu dit
Malecourrède). Son père était Jean
Meilhon dit Abadie.
Henri
Meilhon (Sosa 298), né le 11
mars 1676 à Saint-Julien, était laboureur et a exercé la charge de jurat à Lescar. Sa tombe est elle-aussi
dans la cathédrale (voir ci-contre à droite). Il a été marié à Marie
Bourdiu dite Malecourrède. Il est décédé le 10 mars
1751 (St Julien). Il a été dit « Laprima » car sa mère
s’appelait
Domengine Lassus dite Laprima, et « Malecourrède » étant
donné le nom
de son épouse (cette dernière étant la petite-fille de Jean Bourdiu dit
Malecourrède). Son père était Jean
Meilhon dit Abadie.Le
plus ancien (dans les
archives) portant ce nom à Lescar était un certain Ramonet Meilhon,
marié (avant
1624) à Agne Labordette. On trouve plus tard un couple Arnaud Meilhon
et Marie
d’Abadie, mariés avant 1633 (ND), qui pourraient être les parents du
Jean
Meilhon vu ci-dessus.
Dans
le terrier de Lescar de 1643, on
trouve « … un champ appartenant à Malacorrède », ainsi qu’un
couple : Jean de "Lassim" (certainement Lassus)
et sa femme Marie de Malacorrède.
3.
Les
Foix (ou de Foix)
Au
début du XVIIème siècle, on
trouve à Lescar une fratrie de Foix, dont nous n’avons pas pu retrouver
les
parents :
a)
Marguerite
de Foix
(Sosa 1357), mariée à
Jean Bégué dit Lassalle (Sosa 1356), chirurgien de Lescar. Ils auront 5
enfants, dont Dominique, qui sera maître chirurgien et jurat,
André qui sera lui aussi maître chirurgien, et Catherine qui
épousera le sculpteur André Giraudy.
b)
Isabeau
de Foix,
qui épousera le
peintre Guillaume d’Alary.
« François Bardou, peintre et
doreur, né à Paris, […] vint à Lescar se marier avec Jeanne-Thérèse
d’Alary,
fille de Guillaume d’Alary, peintre, habitant à Lescar »
[Bulletin de
la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau, 1er Janvier
1873.
Article de Paul Raymond : Notes pour servir à l’histoire des
artistes en
Béarn]. Voir https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k34255c/f132.item
Les liens de sororité entre Marguerite et Isabeau sont attestés dans le
contrat de mariage de Dominique Lassalle (fils de Marguerite) et
d’Isabeau d’Authàa.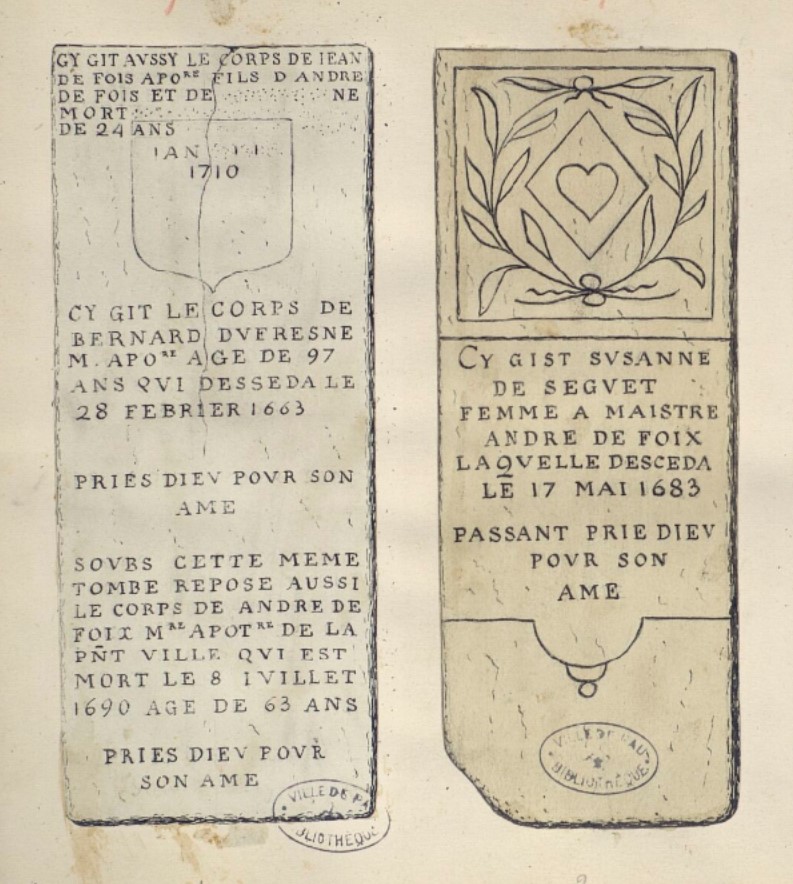
c)
André
de Foix,
maître apothicaire et jurat, qui épousera Suzanne de
Seguet.
André décèdera le 8 juillet 1690, et Suzanne le 17 mai 1683. Ce sont
les tombes d’André et Suzanne (l’une à côté
de l’autre) qui sont données ci-contre à gauche.
Après
le décès de Suzanne, André s’est remarié avec Jeanne Morter dite
Poulit, qui lui donnera deux enfants : Jean de Foix (qui sera
apothicaire
comme son père), et Isabeau de Foix, qui se mariera en 1710 avec
Jean-Pierre Castaing-Foix (qui sera notaire royal
et apostolique de Lescar… et qui lui donnera 14 enfants).
Les
parents de Jean-Pierre Castaing-Foix (Jean Castaing, marchand, et
Catherine Laborde) ont aussi leur pierre
tombale dans la cathédrale.
4) Les Arporet (ou d'Arporet, ou Darporet)
Dans
mes ancêtres Arporet du XVIIème siècle, figure une fratrie composée
de :
-
Bernard
Arporet (Sosa 2148), qui a épousé Honorette
Bertrin (Sosa 2149). Ils auront 7 enfants, dont :
o
Marie
(Sosa 1429) qui épousera Mathieu Lau
o
Bertrand
Arporet (Sosa 1074), qui épousera Marie
Bedora
o
Autre
Bertrand Arporet, avocat, qui épousera Jeanne
Pon. Bertrand et Jeanne auront 8 enfants, dont Marie,
décédée le 15 aout 1698 à l’âge de 36 ans, dont la tombe
est donnée ci-dessus.
- Jean Arporet, qui a épousé Bernardine Gauses. Ils auront 6 enfants. Jean a lui aussi sa tombe à Notre-Dame (voir ci-dessus). Il est décédé le 30 septembre 1623. Peu après, Bernardine se remariera avec Pierre Faur. A côté de celle de Jean, figure la tombe du frère de Bernardine : Bertrand Gauses, apothicaire de Lescar, décédé le 24 novembre 1627.
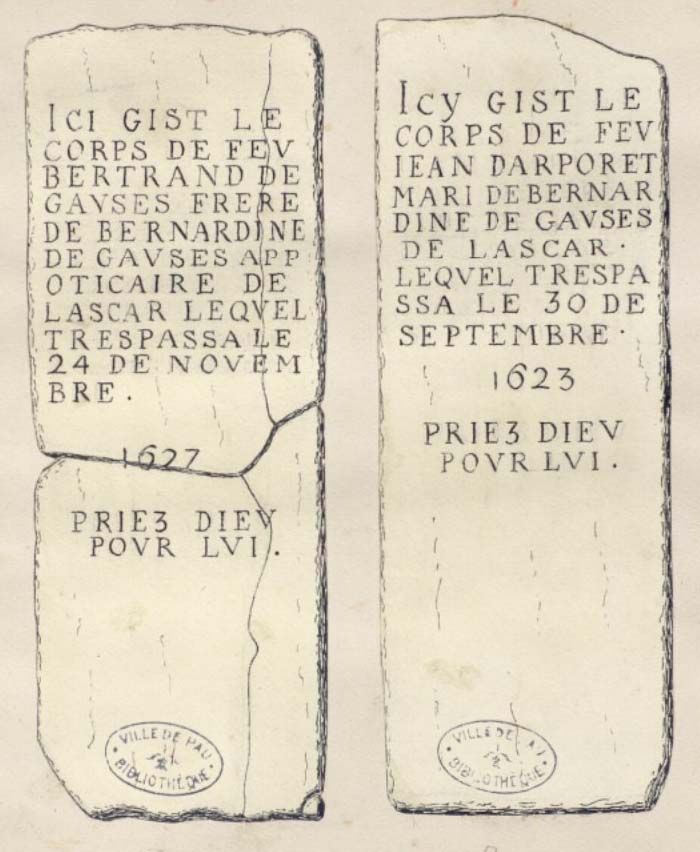 |
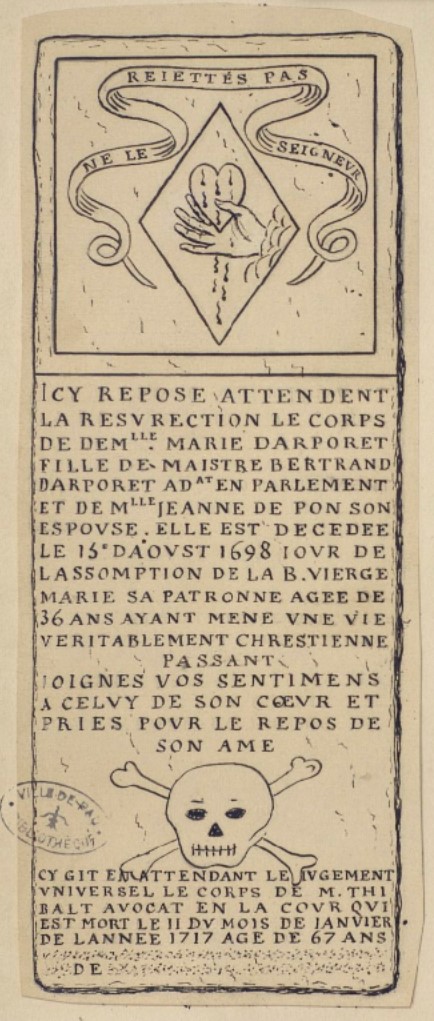 |
Les jurats
Les États de
Béarn se constituent dès la mort de Gaston III Fébus, survenue le 1er août 1391, à partir de la cour des communautés et de la Cour Majour. Ils avaient pour tâche d’assister le vicomte dans ses
fonctions judiciaires. C’était une sorte de tribunal suprême. Ils siègent pour
la première fois le 8 août 1391. Les États de Béarn étaient composés de
deux chambres : le Grand-Corps et le Second-Corps.
Le
Grand-Corps était la chambre du clergé
et de la noblesse.
Ses membres étaient :·les 2 évêques de Lescar et d’Oloron, et
les abbés des trois principales abbayes
du Béarn : celui de l'abbaye
de Sauvelade, celui de l'abbaye
de Larreule et celui de l'abbaye
de Lucq ;
quatorze barons
du Béarn ;
autres gentilshommes.
Le
Second-Corps était la chambre du Tiers-État.
Elle était composée des jurats des quarante-deux communautés d'habitants du Béarn,
notamment Lescar.
Souvent
issus des bourgeois, les jurats
étaient les représentants (élus) de la communauté locale : la communauté des « voisins » (appelée bésiaü). C'étaient les véritables gestionnaires de la
vie publique en Béarn. Notons que la qualité de voisin se transmettait d’une
génération à l’autre : l’héritier (ou l’héritière) seul(e) accédait au
rang de voisin.
Ces
jurats cumulaient les pouvoirs judiciaires et de police. Ils étaient, avec les
gardes, les répartiteurs et percepteurs des impôts de l’état : taille,
etc... Ils étaient aussi chargés de la police, de la sécurité publique, de la
répression, du vagabondage, de l’hygiène publique (assainissement des lieux,
écoulement des eaux, enfouissement des animaux morts, surveillance des jeux et
des cabarets, contrôle des boucheries, des apothicaires, constatation des
filles enceintes, etc.) de la voirie... Ils convoquaient également pour l’ar-mée.
En
tant que délégués du vicomte, ils étaient chargés de la basse et moyenne
justice. Comme juges civils, ils tenaient cour ordinaire au lieu judicial, avec
le bayle et le notaire. Ils avaient là un rôle de conciliateur. Leur jugement
était susceptible d’appel. Ils taxaient les vivres, veillaient à l’observation
des taxes, vérifiaient les poids et les mesures (ce qui n'était pas à l'époque
une mince affaire). Enfin, grand privilège, ils bénéficiaient de la
sonnerie à toute volée lors de leurs obsèques.
Une date-clé
concernant la justice au Béarn est 1620, qui voit Louis XIII créer le Parlement de Navarre et du Béarn, à la
suite du rattachement du Béarn et de la Basse-Navarre à la couronne de France.
Son ressort comprenait le Béarn, la Basse-Navarre et la Soule. Il remplaçait
les organismes mentionnés plus haut, les jurats jouant grosso modo le même rôle
que précédemment.